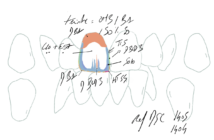Bibliographie
1 Ma R, Liu Q, Zhou L, Wang L. High porosity 3D printed titanium mesh allows better bone regeneration. BMC Oral Health. 2023 Jan 6;23(1):6.
2 Arshad, M.; Khoramshahi, N.; Shirani, G. Additively custom-made 3D-printed subperiosteal implants for the rehabilitation of the severely atrophic maxilla (a case report). Clin. Case Rep. 2023, 11, e8135.
3 Vatteroni, E.; Covani, U.; Fabris, G.B.M. The New Generation of Subperiosteal Implants for Patient-Specific Treatment of Atrophic Dental Arches: Literature Review and Two Case Reports. Int. J. Periodontics Restor. Dent. 2023, 43, 735–741.
4 Cohen DJ, Cheng A, Kahn A, Aviram M, Whitehead AJ, Hyzy SL, Clohessy RM, Boyan BD, Schwartz Z. Novel Osteogenic Ti-6Al-4V Device For Restoration Of Dental Function In Patients With Large Bone Deficiencies: Design, Development And Implementation. Sci Rep. 2016 Feb 8;6:20493.
5 Bollen CM, Papaioanno W, Van Eldere J, Schepers E, Quirynen M, van Steenberghe D. The influence of abutment surface roughness on plaque accumulation and peri-implant mucositis. Clin Oral Implants Res. 1996 Sep;7(3):201-11.
6 Roy M, Chelucci E, Corti A, Ceccarelli L, Cerea M, Dorocka-Bobkowska B, Pompella A, Daniele S. Biocompatibility of Subperiosteal Dental Implants: Changes in the Expression of Osteogenesis-Related Genes in Osteoblasts Exposed to Differently Treated Titanium Surfaces. J Funct Biomater. 2024 May 27;15(6):146.
7 Claffey N, Bashara H, O'Reilly P, Polyzois I. Evaluation of New Bone Formation and Osseointegration Around Subperiosteal Titanium Implants with Histometry and Nanoindentation. Int J Oral Maxillofac Implants. 2015 Sep-Oct;30(5):1004-10. doi: 10.11607/jomi.3647. PMID: 26394334.
8 O’Connell, J.; Murphy, C.; Ikeagwuani, O.; Adley, C.; Kearns, G. The fate of titanium miniplates and screws used in maxillofacial surgery: A 10 year retrospective study. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2009, 38, 731–735.
9 Cornelis, M.A.; Scheffler, N.R.; Mahy, P.; Siciliano, S.; De Clerck, H.J.; Tulloch, J.C. Modified Miniplates for Temporary Skeletal Anchorage in Orthodontics: Placement and Removal Surgeries. J. Oral Maxillofac. Surg. 2008, 66, 1439–1445.
10 Vatteroni E, Toti P, Covani U, Crespi R, Cosola S, Menchini-Fabris GB. A Retrospective Radiological and Clinical Survey of Full-Arch Immediate Fixed Prostheses Supported by Custom-Made Three-Dimensional Printed Subperiosteal Titanium Implants in Patients with Severe Atrophic Jaws: Implant Success Code. Int J Oral Maxillofac Implants. 2025 Mar 13;0(0):1-27.
11 Zielinski R, Sowinski J, Piechaczek M, Okulski J, Kozakiewicz M. Finite Element Analysis of Subperiosteal Implants in Edentulism-On the Basis of the MaI Implant ® by Integra Implants ® . Materials (Basel). 2023 Nov 30;16(23):7466.
12 History and evolution of Implants. https://fr.slideshare.net/slideshow/history-and-evolution-of- implants1pptx/259920980
13 Adell R, Hansson BO, Brånemark PI, Breine U. Intra-osseous anchorage of dental prostheses. II. Review of clinical approaches. Scand J Plast Reconstr Surg. 1970;4(1):19-34.
14 Birault L. and Diss A. Subperiosteal implants for the rehabilitation of atrophic posterior mandibular regions: A bilateral case report. Implant Practice US. 2023;17(3)
15 Kratochvil FJ, Boyne PJ. Combined use of subperiosteal implant and bone-marrow graft in deficient edentulous mandibles: a preliminary report. J Prosthet Dent. 1972 Jun;27(6):645-53.
16 Aaboe M, Schou S, Hjørting-Hansen E, Helbo M, Vikjaer D. Osseointegration of subperiosteal implants using bovine bone substitute and various membranes. Clin Oral Implants Res. 2000 Feb;11(1):51-8.